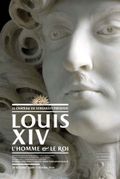
Hier soir, avant l’arrivée des invités de Moët-Hennessy, j’en profite pour revoir tranquillement, quelques uns des chefs d’œuvres que rassemble l’exposition
Louis XIV, l’homme et le roi. De nombreuses questions traversent mon esprit et animent ma réflexion. Comment le goût d’un homme, en l’occurrence celui de Louis XIV, se forme t’il ? Comment le goût d’un homme, en l’occurrence, celui d’un roi, peut-il déterminer l’aventure artistique d’une nation toute entière ? Comment le goût du même homme évolue t’il d’un bout à l’autre de sa vie, surtout quand cette vie a été, ce qui est le cas pour Louis XIV, longue ?
Le goût de Louis XIV, en tout cas ce que j’appellerai son « premier goût », celui des cinquante premières années de son existence et dont le terme correspond à peu près à l’épanouissement du « premier Versailles » louis-quatorzien, résulte à la fois de l’air de son temps, de l’influence de son parrain, le Cardinal Mazarin, immense collectionneur, de l’italianisme encore dominant en Europe et que soutenait dans la sensibilité du roi le souvenir de sa grand-mère, Marie de Médicis et la présence des italiens à la cour de France, celle des Concini qui allaient mal finir et bien sûr celle de Jules Mazarin. Ce goût se forme aussi au contact de certains modèles, collectionneurs et mécènes, parmi lesquels Nicolas Fouquet occupe une place prépondérante. Faut-il ajouter que le « prince collectionneur », que ce soit Charles Ier d’Angleterre ou Philippe IV d’Espagne, devient alors un modèle qui s’impose à l’Europe toute entière. C’est, sur ce terrain que naît l’amour des arts de Louis XIV et celui d’ailleurs aussi de son frère, Monsieur, et, plus tard, celui de Monseigneur le Dauphin dont la collection surpassa peut-être en personnalité celle de son père. Ce goût,  c’est un goût baroque. En témoignent dans l’exposition, le cabinet Cucci, les tables de pierre dure, les gemmes et les pièces d’orfèvrerie. L’escalier de la reine qui subsiste toujours, la dorure des ornements de la toiture du corps central, aujourd’hui en cour de rétablissement, et que certains décrient, renvoient vers cette esthétique baroque, riche, profuse, à la recherche de mariages improbables de matériaux divers et de couleurs heurtées. Le cabinet Cucci (de la paire qui appartient au Duc de Northumberland et qui fut vendu par le Garde-Meuble dès 1751, le goût de ces pièces baroques ayant alors passé), fait partie de ces objets « limites », à la limite du sublime, du beau, du monstrueux et de l’étrange, dans ce « limès » de la sensibilité et de l’esthétique où les baroques européens ont puisé leur prodigieuse audace.
c’est un goût baroque. En témoignent dans l’exposition, le cabinet Cucci, les tables de pierre dure, les gemmes et les pièces d’orfèvrerie. L’escalier de la reine qui subsiste toujours, la dorure des ornements de la toiture du corps central, aujourd’hui en cour de rétablissement, et que certains décrient, renvoient vers cette esthétique baroque, riche, profuse, à la recherche de mariages improbables de matériaux divers et de couleurs heurtées. Le cabinet Cucci (de la paire qui appartient au Duc de Northumberland et qui fut vendu par le Garde-Meuble dès 1751, le goût de ces pièces baroques ayant alors passé), fait partie de ces objets « limites », à la limite du sublime, du beau, du monstrueux et de l’étrange, dans ce « limès » de la sensibilité et de l’esthétique où les baroques européens ont puisé leur prodigieuse audace.
L’influence du goût ou plus exactement de la passion de Louis XIV sur le mouvement des arts de son temps est patente. C’est lui qui, à travers son œuvre de commanditaire forge la personnalité d’une « école française », en littérature, en musique, en architecture, dans l’art des jardins, et dans toute les activités de production d’objets décoratifs. Ce goût français naît d’abord d’une capacité spécifique d’interprétation des modèles internationaux, pour employer un néologisme, c’est à dire italiens et, dès les années 1680, de la faculté d’orienter la production française vers de nouveaux modèles, vers une nouvelle esthétique. Lully, bien qu’italien, invente sans rien oublier des leçons de son pays, une musique que sa couleur spécifique distingue aussitôt, à la première mesure, de toutes les autres, la musique française. Dans le même temps, alors que le roi commande cet édifice bizarre et baroque qu’est la

grotte de Thétis, on y place
le groupe des bains d’Apollon, Apollon servi par les nymphes de François Girardon, chef d’œuvre annonciateur de ce qui va devenir le classicisme français et dont l’apothéose est, sans doute, sous le règne de Louis le Grand, la chapelle conçue par Mansart, ouverte au culte en 1710 seulement, alors que s’annonce déjà l’esthétique d’un nouveau siècle.
Quant à la révolution du goût, c’est vraiment le demi-siècle du règne personnel du Roi qui en aura été le terreau. C’est ce demi-siècle qui, sur l’impulsion personnelle du Roi soleil, grâce à la relation très étroite et souvent fidèle qu’il entretint avec les artistes de son temps, grâce au caractère très résolu, très directif dirait-on aujourd’hui, de son rôle de commanditaire d’œuvres, de bâtisseur et de mécène, qu’on verra le temps glisser d’une esthétique à l’autre, au point, que, quelques décennies plus tard, le goût du siècle des lumières aura du mal à

cohabiter avec les productions artistiques des premières décennies du règne du grand Roi. C’est alors que Versailles se dépouillera de beaucoup des décors et de beaucoup des meubles témoins de ce temps héroïque.
L’exposition
Louis XIV, l’homme et le roi conçue par Nicolas Milovanovic et Alexandre Maral nous invite à cette exploration qui, outre son intérêt historique intrinsèque, permet de mieux comprendre Versailles, le Versailles toujours visible et le Versailles disparu.
Les éditions Citadelle & Mazenod font paraître un double album consacré à Versailles, réalisé sous la direction de Pierre Arizzoli-Clémentel. Ces deux albums illustrés de façon impressionnante par les photographies de Pierre Walter, rassemble un remarquable florilège de contributions historiques qui couvrent l’histoire du château de Louis XIII à aujourd’hui en passant par le règne des trois Louis, sans omettre celui de Louis-Philippe et, de façon générale, la contribution du XIXè siècle à l’identité actuelle du château. C’est vraiment impressionnant, encore que par son format et son poids, l’ouvrage soit d’une lecture difficile et que son prix (670 €) en fasse plus un ouvrage de bibliophilie qu’un outil de travail et d’étude. Dommage aussi que, dans les annexes, la liste des directeurs du Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon s’arrête à Pierre Arizzoli-Clémentel et ne mentionne pas son successeur, Béatrix Saule, et qu’on omette de préciser la liste des présidents de l’Etablissement public puisque depuis 1995 le Musée est pourvu de cette forme juridique. Hubert Astier, Christine Albanel et moi-même aujourd’hui auront autant compté dans l’histoire de la prise en charge du patrimoine de Versailles que bien des conservateurs dont le monument qu’est cet ouvrage veut bien rappeler le nom ! Je regrette cette petite « damnatio memoriae ».
Les commentaires récents